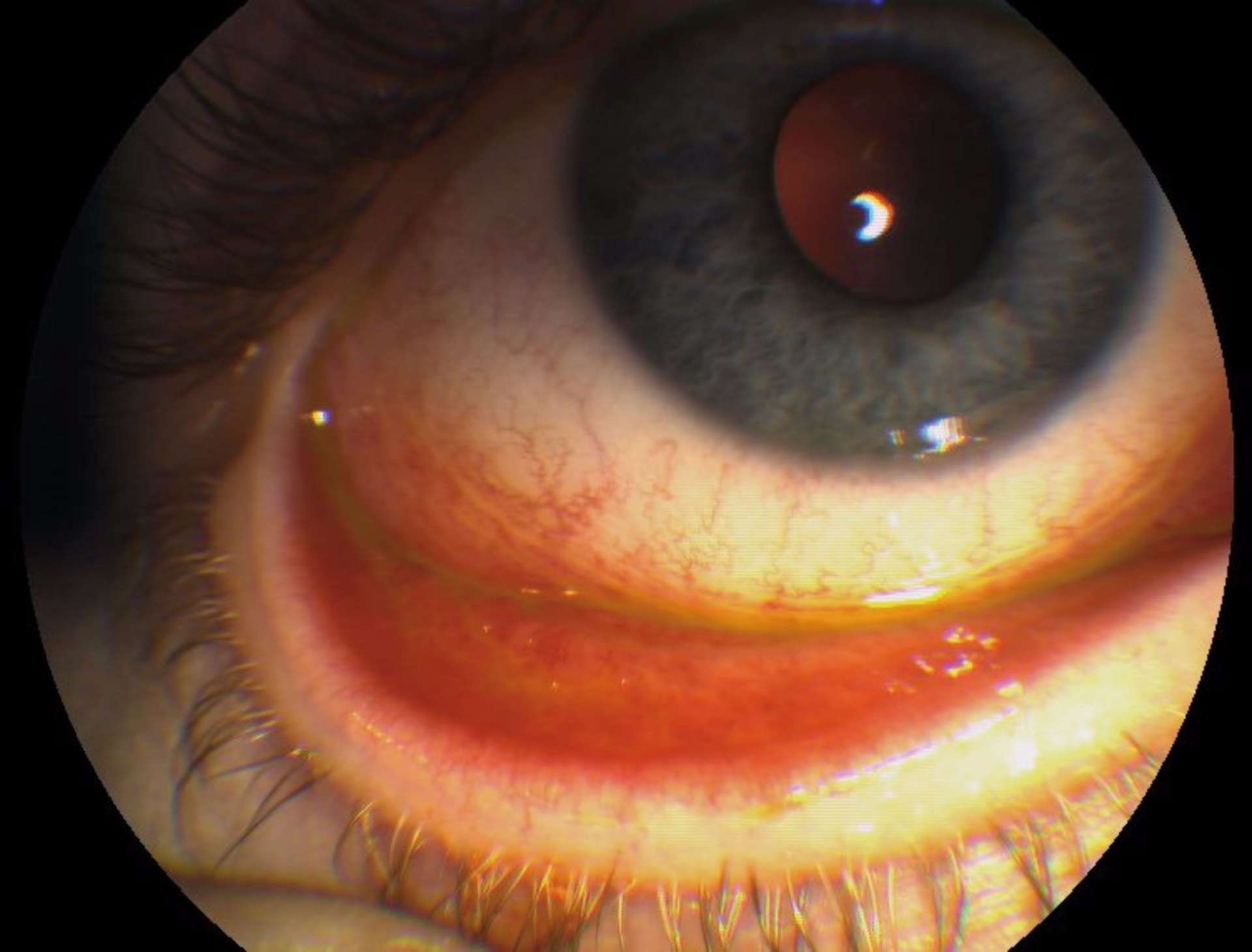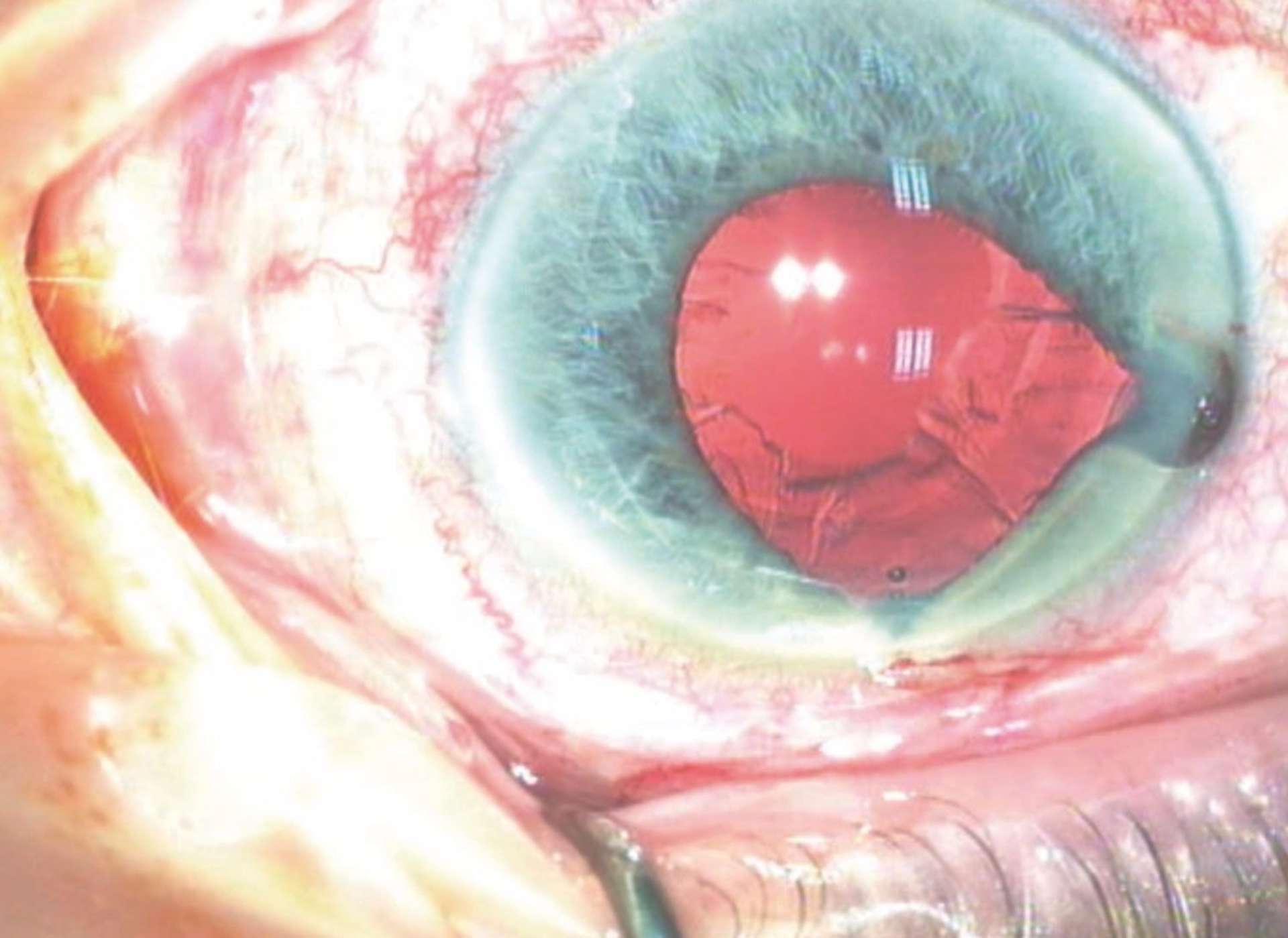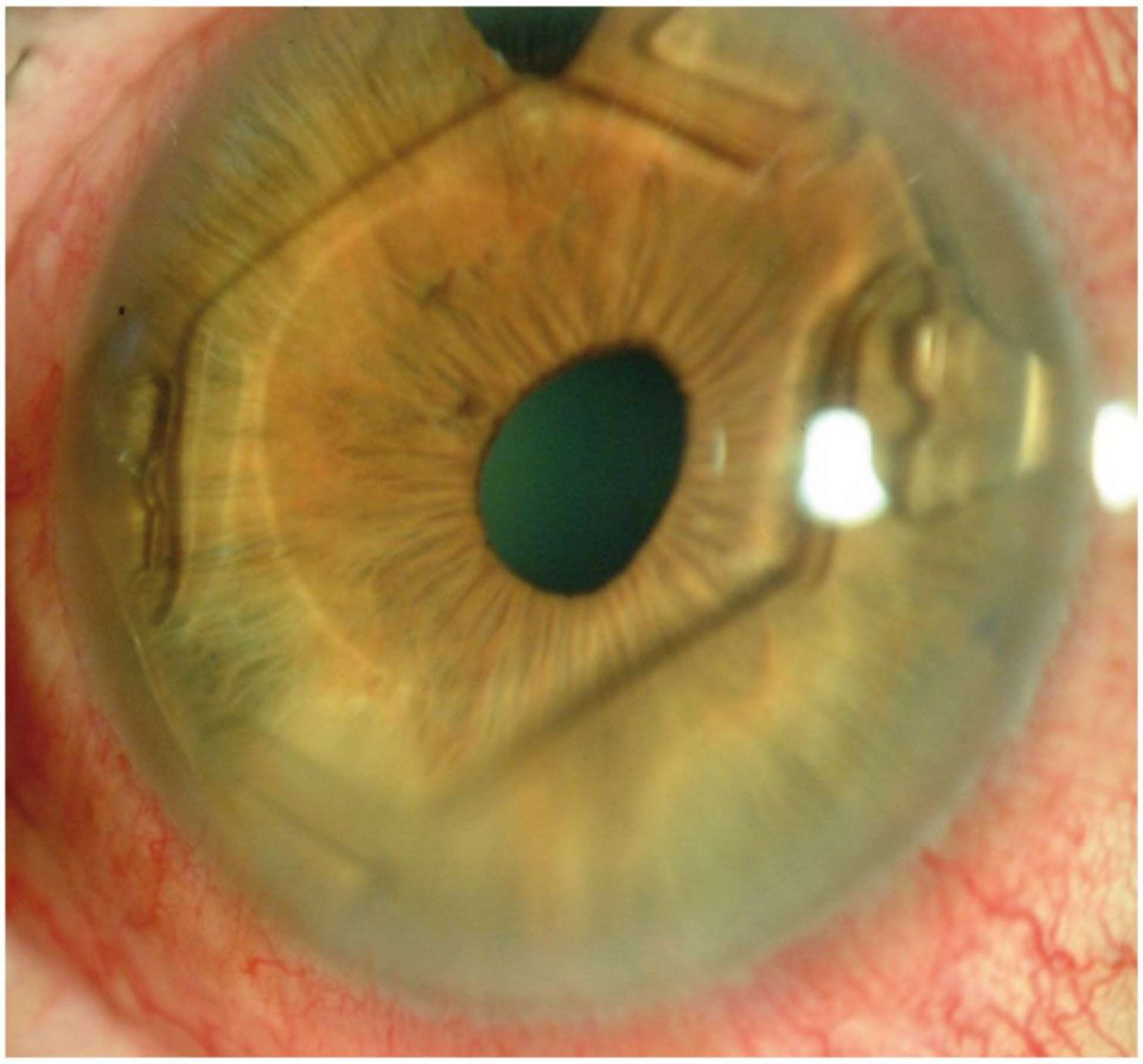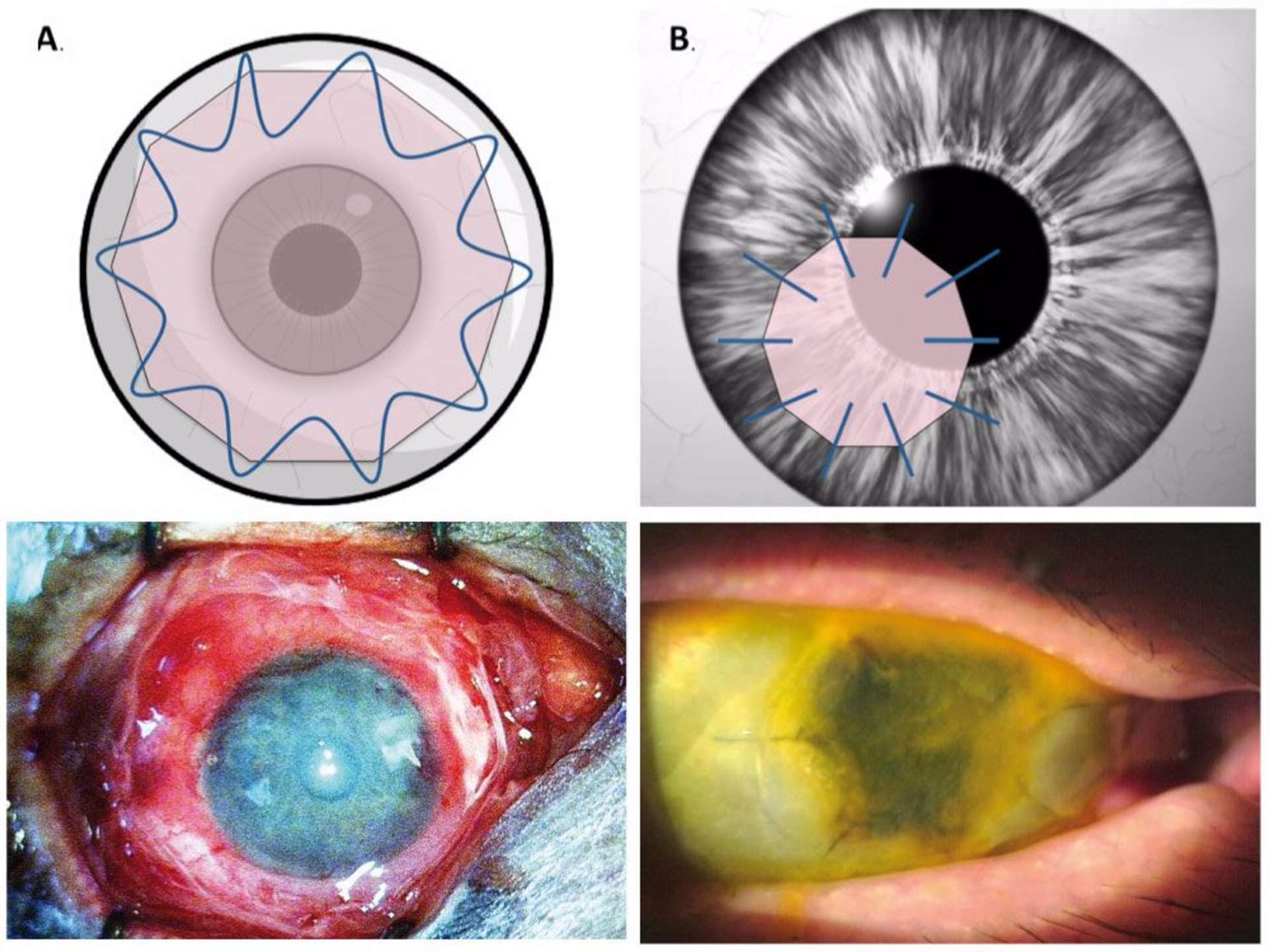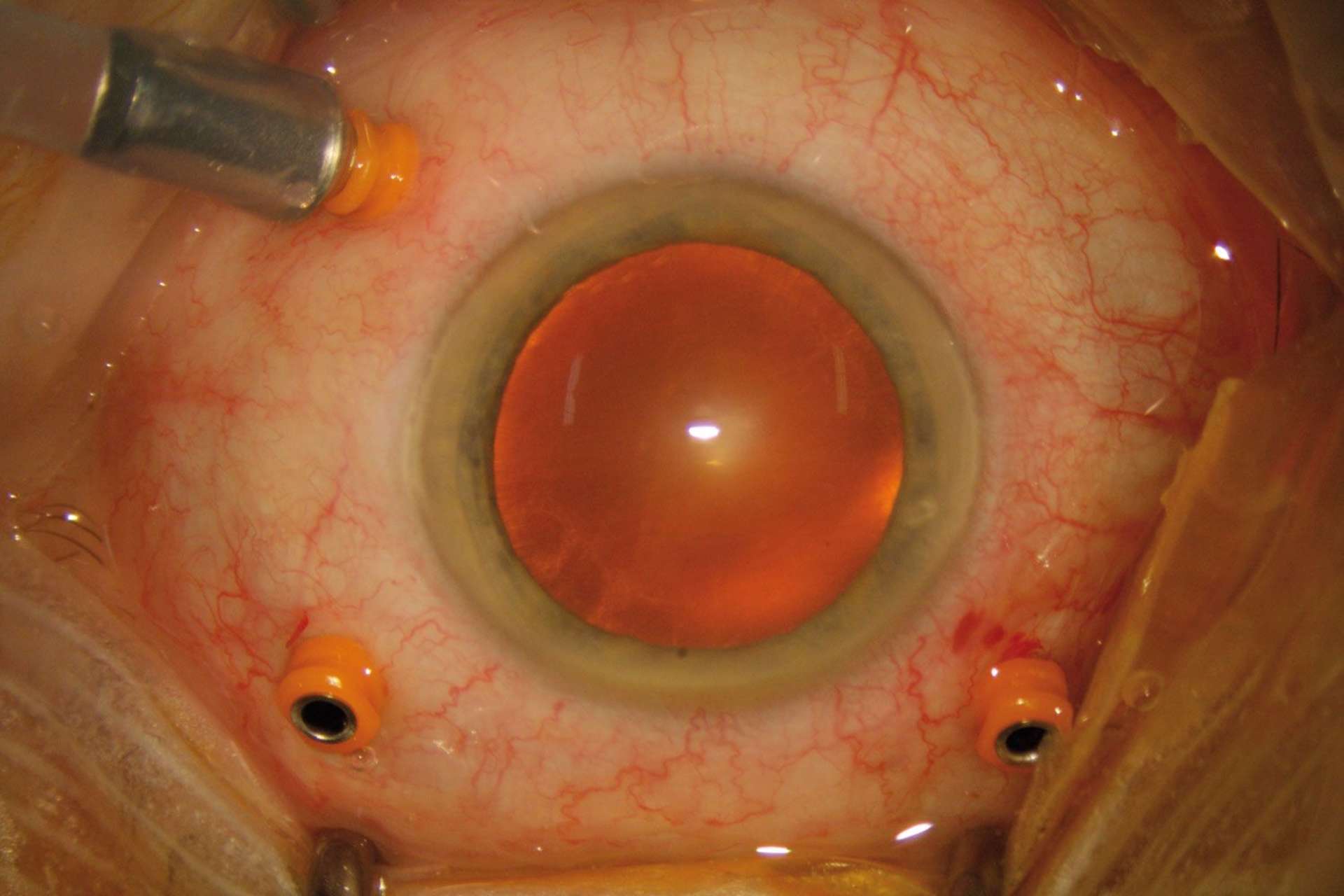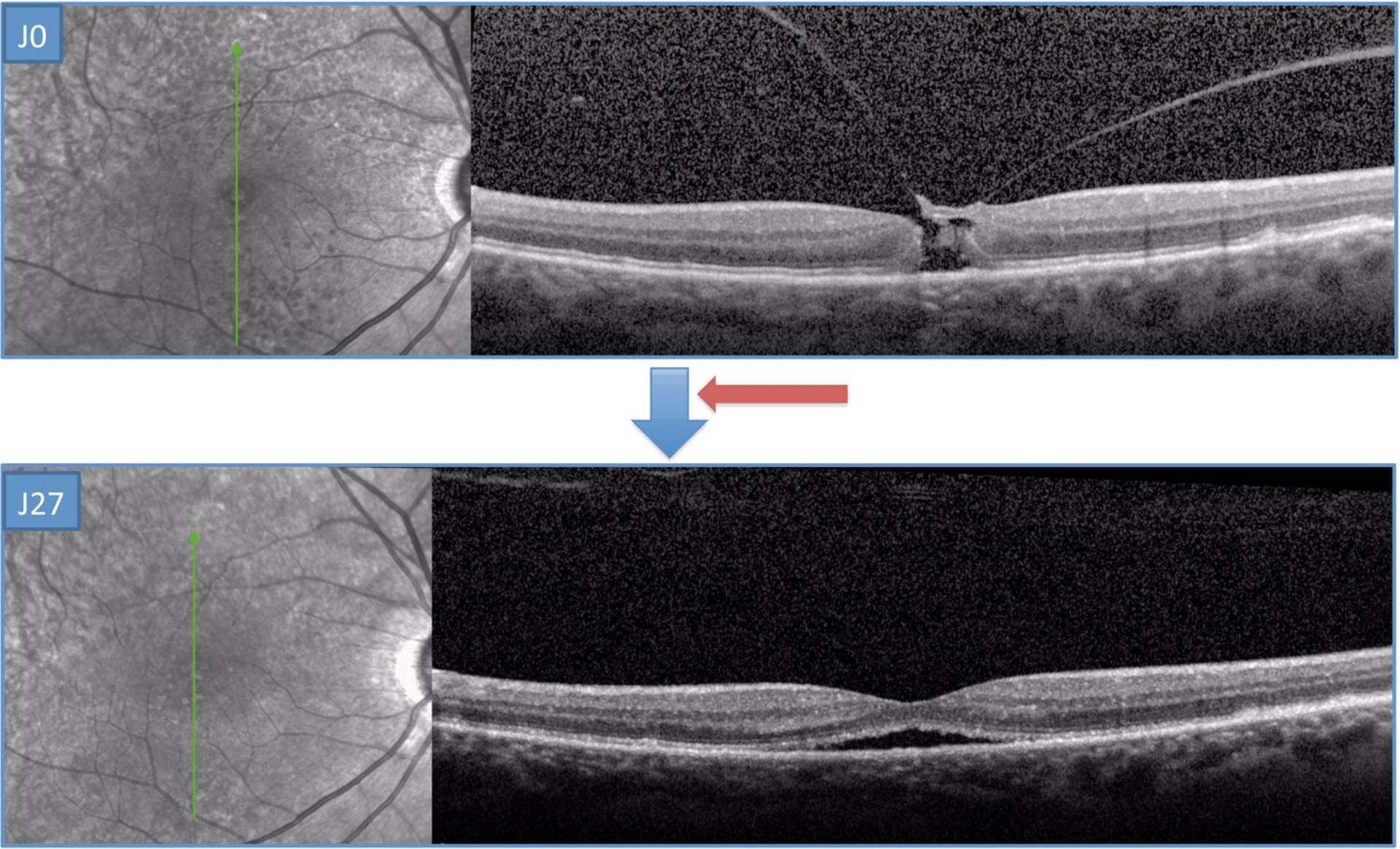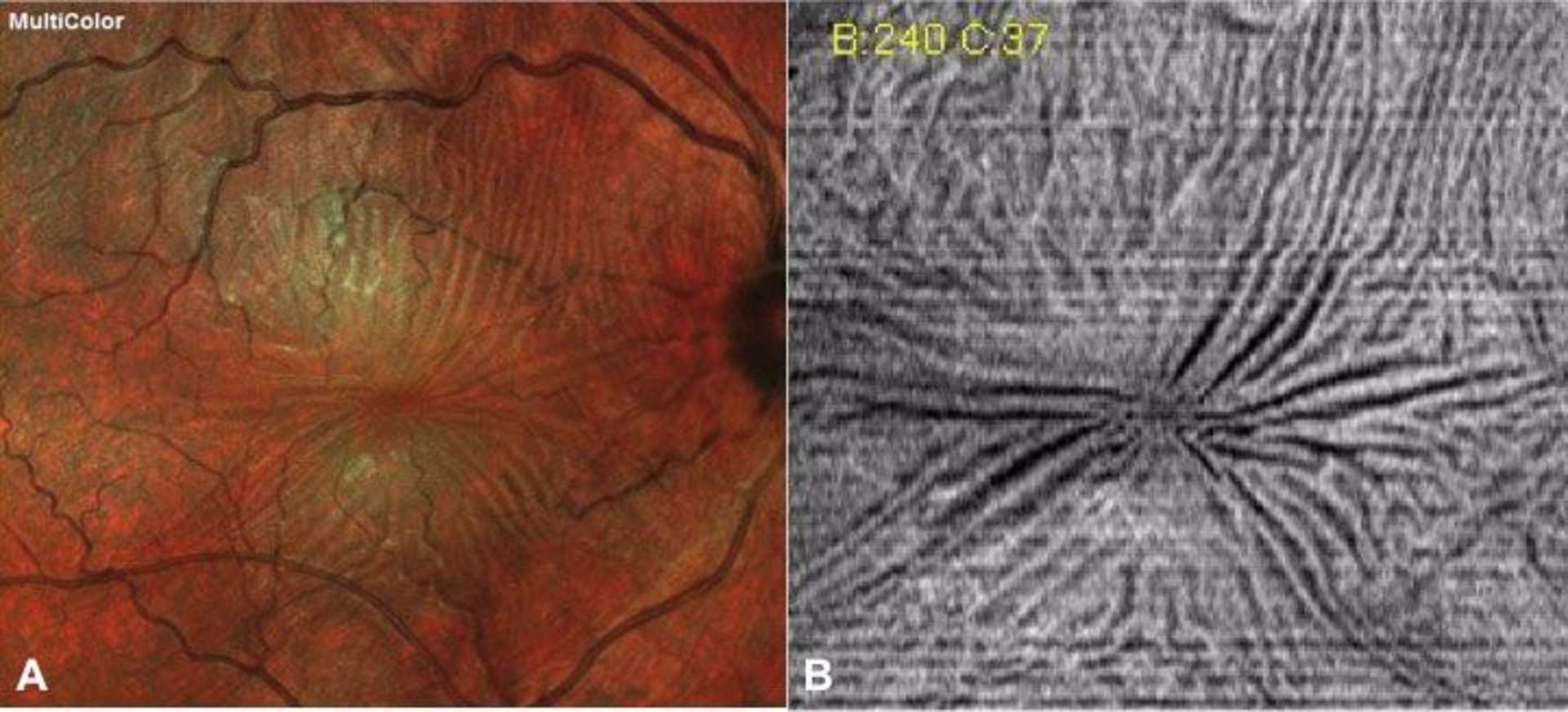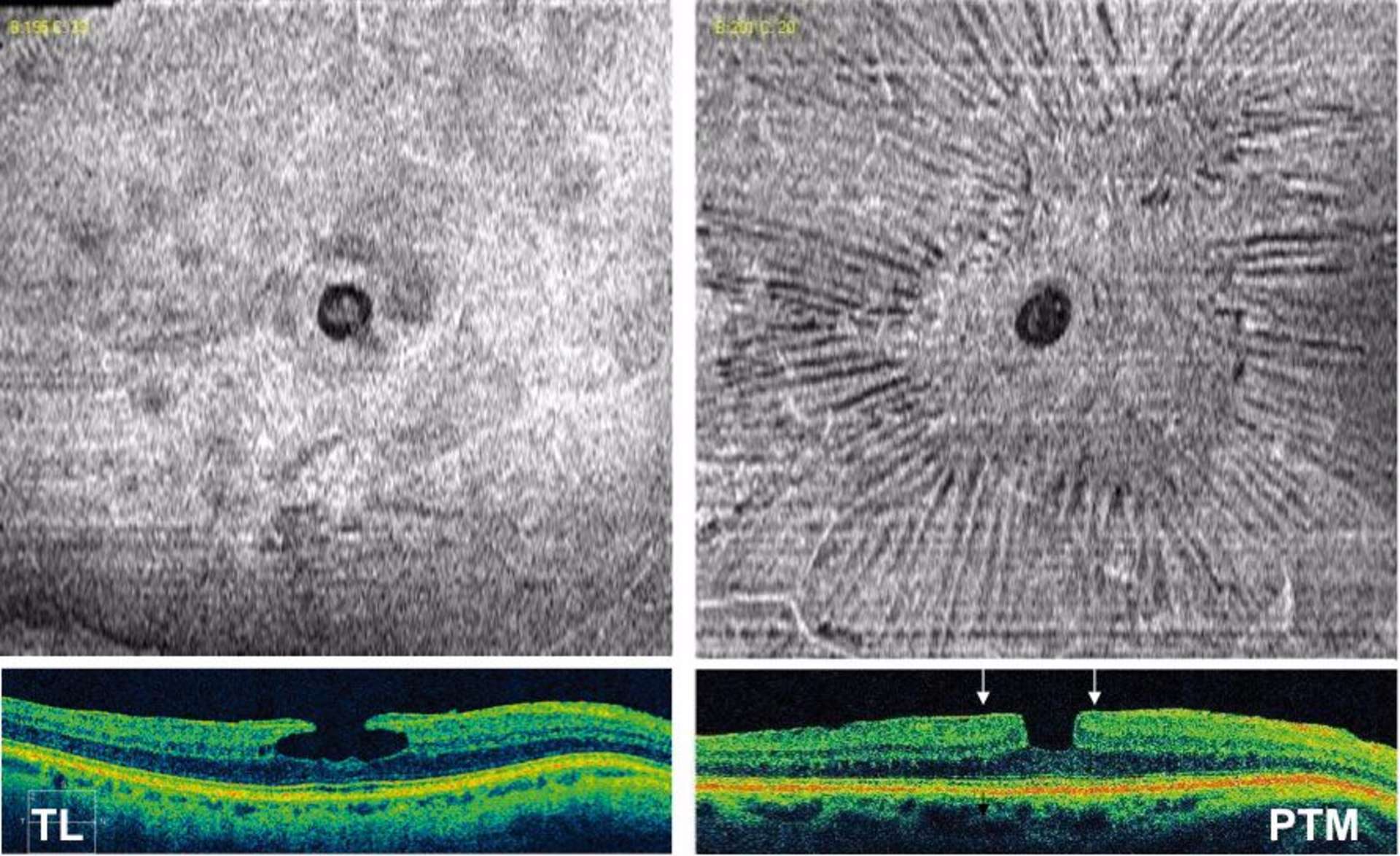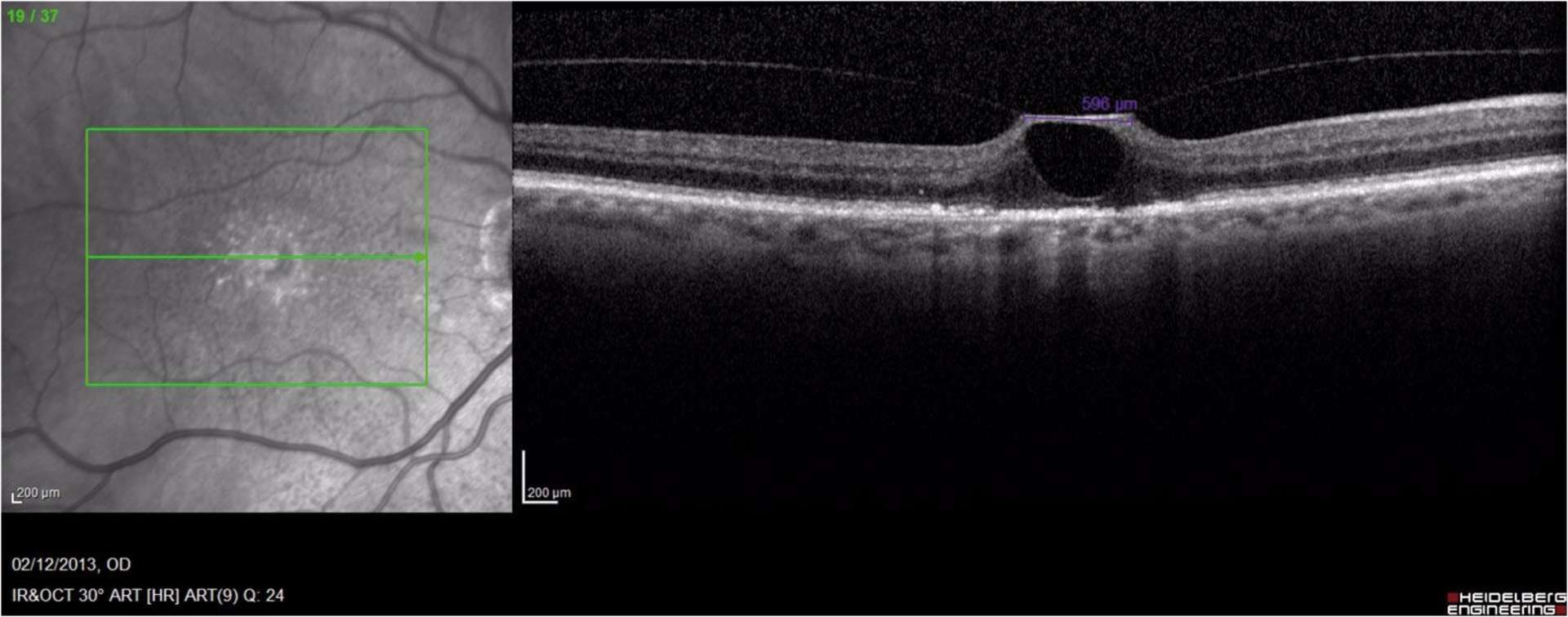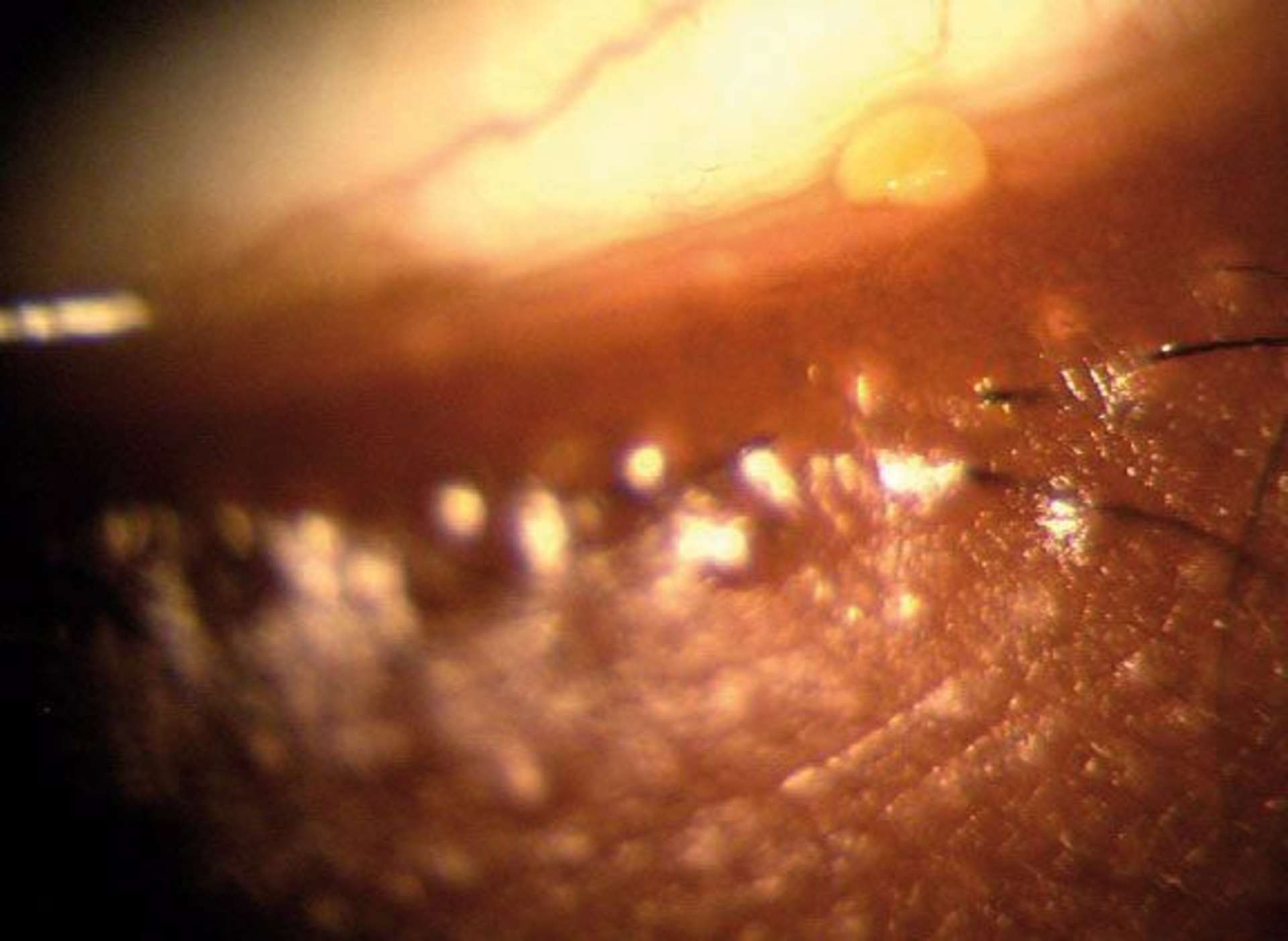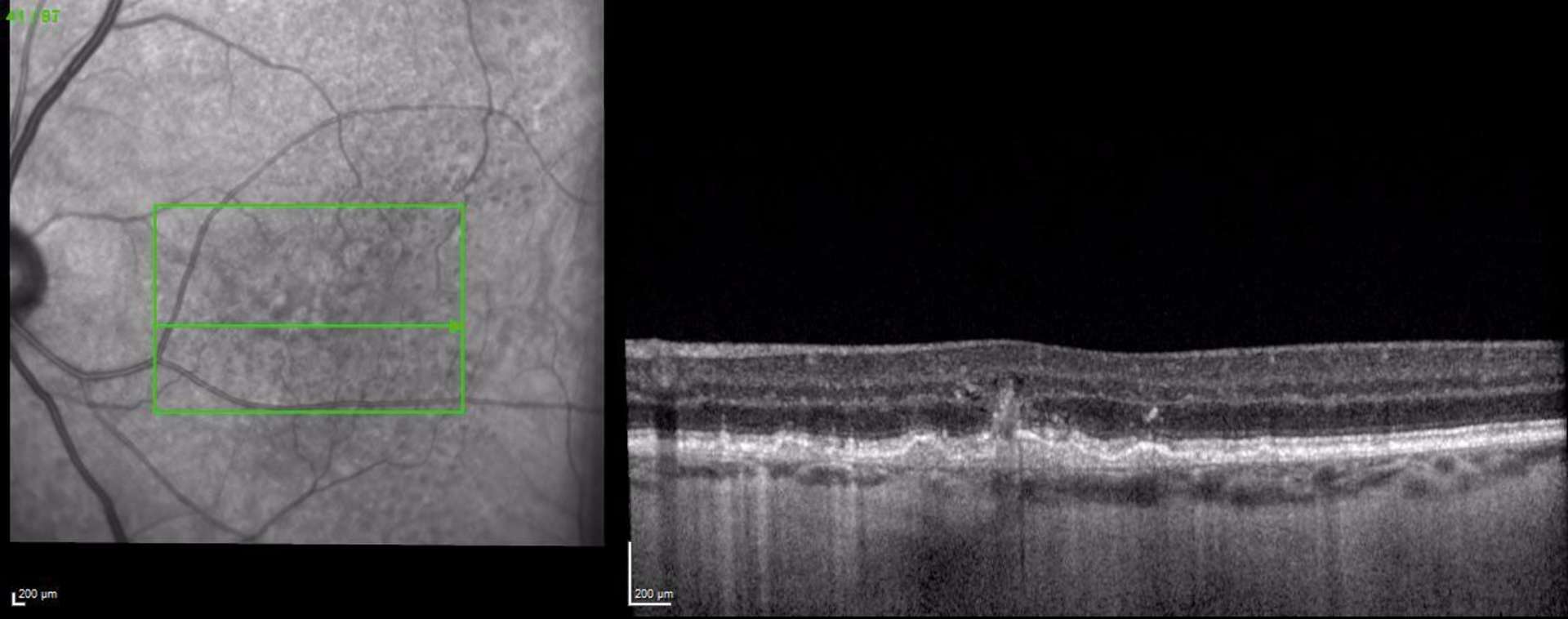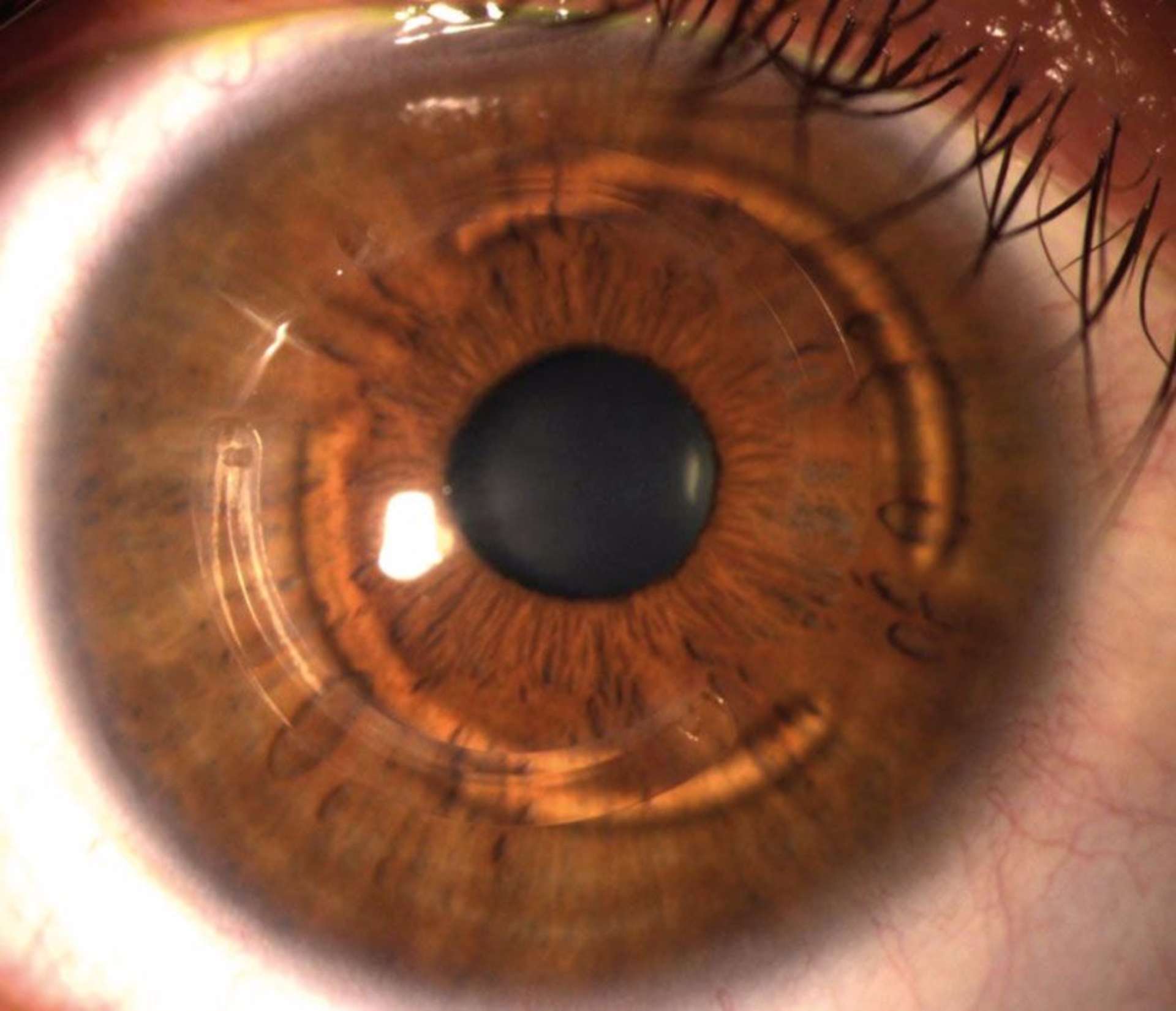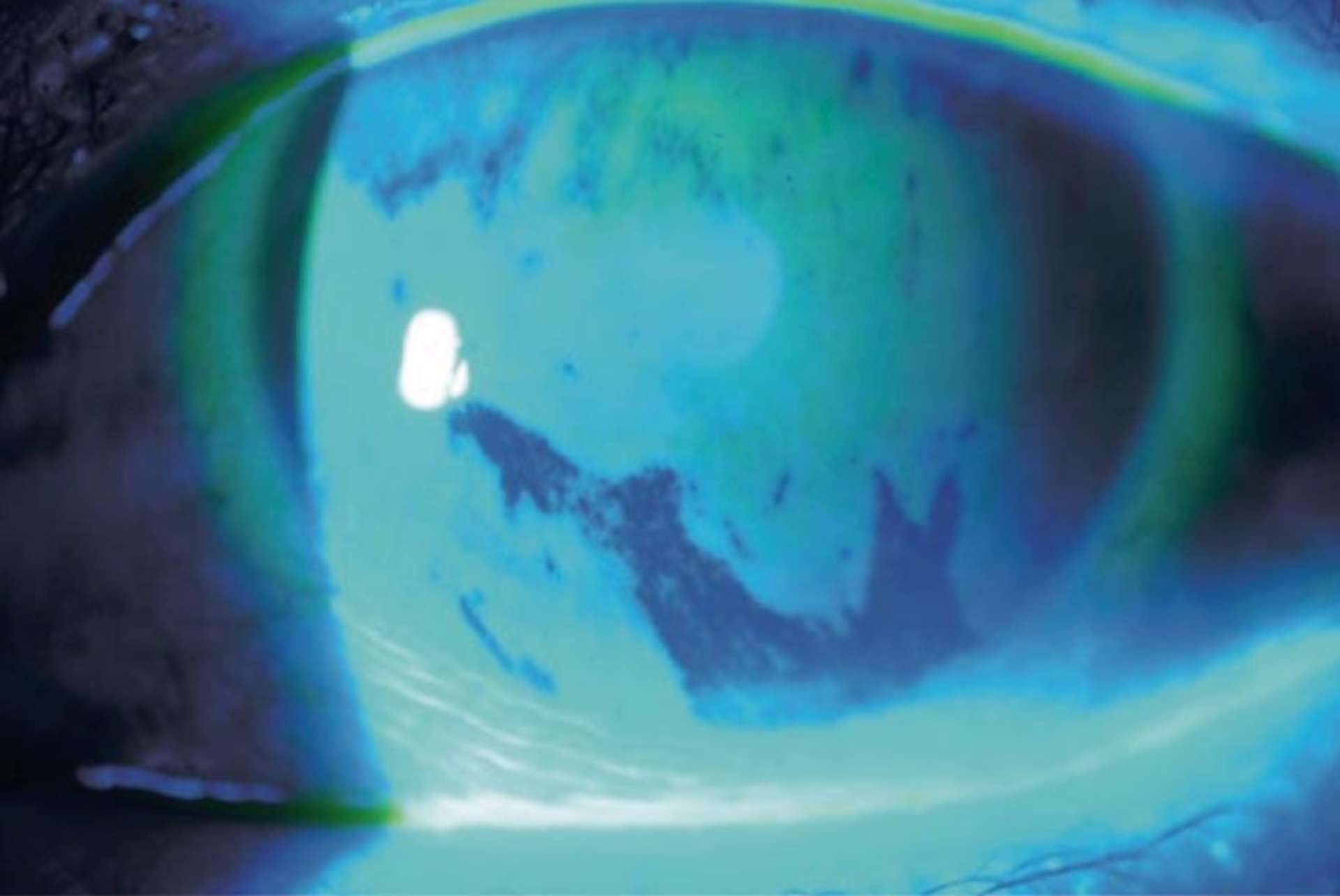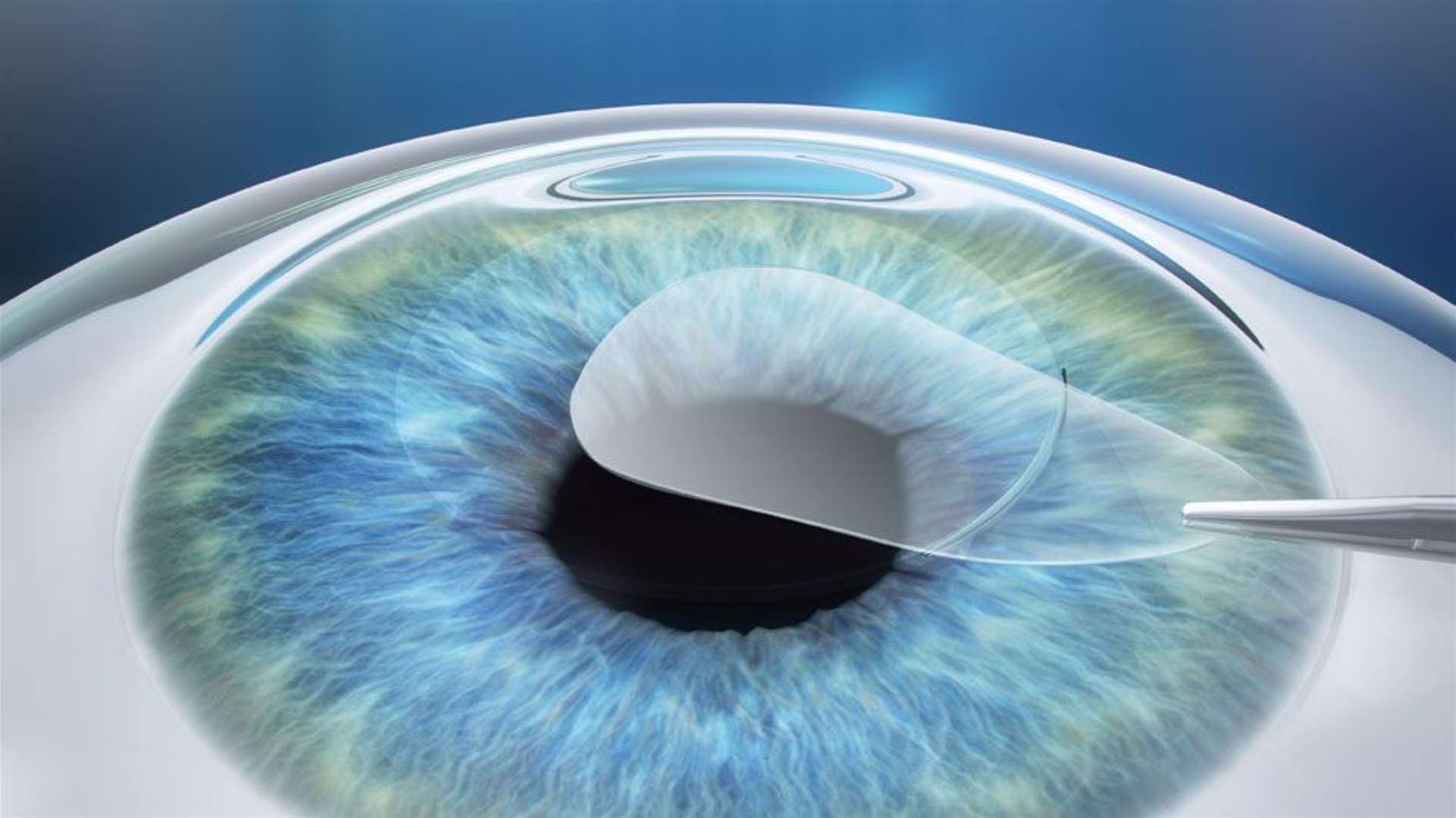Photothèque
A-RIO
Cité mondiale - Bordeaux - France
Aquitaine Rencontres Interactives en Ophtalmologie
Informations : Lien
Rétine en pratique
Paris - France
Journée d'enseignement en présentiel. Maison de la Chimie à Paris.
Informations : Lien
Journée mondiale d’uvéite
Divers événements - Monde
Des experts de premier plan partagent leur point de vue sur l’importance de la sensibilisation à l’uvéite.
Renseignements : Lien
Congrès de la SFO
Palais des Congrès de Paris - France
132e édition des congrès de la Société Française d'Ophtalmologie
Informations : Lien
Congrès du CFSR
Palais des Congrès de Paris - France
XIXe congrès annuel du Club Francophone des Spécialistes de la Rétine
Informations : Lien
MONTI
Palais du Pharo - Marseille - France
Marseille Ophtalmologie : Nouveauté en Thérapeutique et Imagerie
Le thème de l’édition 2026, Regards Croisés, met en lumière la richesse des échanges et des complémentarités dans nos domaines d’expertise respectifs. Cette édition promet d'apporter tous les outils, nouveautés et données scientifiques, avec comme objectif premier de proposer à vos patients jeunes et âgés, le meilleur suivi ophtalmologique qu’il soit.
Informations : Lien
SFOALC
Nice - France
Biennale de la Société Française des Ophtalmologistes Adapatateurs des Lentilles de Contacts. Hôtel Westminster.
Informations : Lien
Formule 100% web
- Consultation illimitée de tous les numéros sur le site